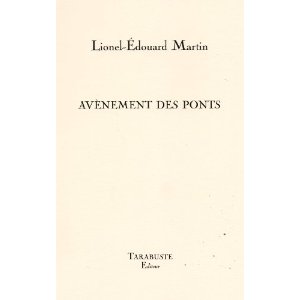Archives d’Auteur: Lionel-Édouard
Catulle, VII : le nombre des baisers / Quaeris quot mihi basiationes
Combien, demandes-tu, Lesbie, de tes baisers
Me faudrait-il pour m’assouvir et me combler ?
Compte les grains de sable où pousse la férule
En Libye, à Cyrène, entre le temple où brûle
Jupiter et la tombe antique de Battos ;
Ou les astres nombreux, quand se tait le cosmos,
Qui scrutent les amours furtives des mortels :
C’est autant de baisers qu’il faut, à un fou tel
Que moi, donner pour l’assouvir et le combler.
Leur nombre ? Cachons-le, de peur qu’un indiscret
Ou quelque médisant n’aille nous envoûter.
***
Cette traduction originale, due à Lionel-Édouard Martin, relève du droit de la propriété intellectuelle.
Il est permis de la diffuser, à la condition expresse que le nom du traducteur soit clairement indiqué.
***
Quaeris, quot mihi basiationes
tuae, Lesbia, sint satis superque.
Quam magnus numerus Libyssae harenae
lasarpiciferis iacet Cyrenis
oraclum Iovis inter aestuosi
et Batti veteris sacrum sepulcrum;
aut quam sidera multa, cum tacet nox,
furtivos hominum vident amores:
tam te basia multa basiare
vesano satis et super Catullo est,
quae nec pernumerare curiosi
possint nec mala fascinare lingua.
Catulle, XVI : contre Aurelius et Furius / ad Aurelium et Furium
Je vous enculerai, vous sucerez ma queue,
Tarlouze d’Aurélius, et toi, Furius, pédé :
Vous avez lu mes vers, assez pour vous fonder
À me croire impudique : ils sont licencieux.
Un poète bien sûr doit être chaste et pieux,
Mais pourquoi faudrait-il que le soient ses poèmes ?
Eux sont plus amusants – et plus jolis, quand même ! –
S’ils défient la pudeur et sont licencieux,
Et s’ils ont le pouvoir d’exciter de picots
Certes pas le blanc bec, mais l’adulte poilu
Ankylosé de reins qui le tiennent perclus !
Vous deux, pour avoir lu mon « milliers de bécots »*,
Vous me jugez à peine mâle ou juste un peu ?
– Je vous enculerai, vous sucerez ma queue.
* : allusion à un célèbre poème de Catulle.
***
Cette traduction originale, due à Lionel-Édouard Martin, relève du droit de la propriété intellectuelle.
Il est permis de la diffuser, à la condition expresse que le nom du traducteur soit clairement indiqué.
***
Pedicabo ego vos et irrumabo,
Aureli pathice et cinaede Furi,
qui me ex versiculis meis putastis,
quod sunt molliculi, parum pudicum.
Nam castum esse decet pium poetam
ipsum, versiculos nihil necesse est;
qui tum denique habent salem ac leporem,
si sunt molliculi ac parum pudici,
et quod pruriat incitare possunt,
non dico pueris, sed his pilosis
qui duros nequeunt mouere lumbos.
Vos, quod milia multa basiorum
legistis, male me marem putatis?
pedicabo ego uos et irrumabo.
Catulle, XXXIII : contre les Vibennius, père et fils
Prince des rapineurs en bains-douches, tonton
Vibennius et toi, son pédé de fiston
(Car si la main du père est culottée de crasse,
Le fils a quant à lui le cul plutôt vorace) :
Mais fichez donc le camp sous de tristes tropiques !
Dès lors que les larcins du père sont connus
De chacun, et du fils le popotin velu,
Pour en tirer des sous, désormais, c’est bernique !
***
Cette traduction originale, due à Lionel-Édouard Martin, relève du droit de la propriété intellectuelle.
Il est permis de la diffuser, à la condition expresse que le nom du traducteur soit clairement indiqué.
***
O furum optime balneariorum
Vibenni pater et cinaede fili
(nam dextra pater inquinatiore,
culo filius est voraciore),
cur non exilium malasque in oras
itis? quandoquidem patris rapinae
notae sunt populo, et natis pilosas,
fili, non potes asse venditare.
Sylvana Périgot : 3 balles perdues (éditions Éolienne, 2012)
 Disons-le d’emblée : l’intrigue de ce premier roman de Sylvana Périgot n’est pas ce qui m’a le plus retenu. La matière narrative peut se résumer en quelques termes : un lieu (un lac dans une forêt peu fréquentée), un personnage principal (et son point de vue, peut-être un peu court, de narrateur unique), une rencontre, un meurtre, deux temporalités croisées.
Disons-le d’emblée : l’intrigue de ce premier roman de Sylvana Périgot n’est pas ce qui m’a le plus retenu. La matière narrative peut se résumer en quelques termes : un lieu (un lac dans une forêt peu fréquentée), un personnage principal (et son point de vue, peut-être un peu court, de narrateur unique), une rencontre, un meurtre, deux temporalités croisées.
Il n’est pas certain que tout cela, mis en scène dans une composition souffrant, m’est avis, de quelques maladresses, suffise à vous emporter dans une de ces lectures qui vous incite, pris d’une fringale insatiable, à vous goinfrer d’un texte. Non : il n’en va pas ici d’une dévoration mais d’une de ces dégustations qui impose la mâche lente pour en saisir toutes les saveurs, et les saveurs les plus subtiles : l’amateur de ces « polars » évoqués dans la quatrième de couverture peut aller chercher ailleurs sa pitance.
Car, en dépit de quelques facilités qui irritent çà et là, 3 balles perdues (titre, il me semble, indu, trop accrocheur et qui circonscrit mal la tonalité très particulière de ce roman) est une de ces petites merveilles que l’on savoure avec lenteur, et pour ce qu’il est dans son essence : un long, magnifique, poème en prose, magistralement orchestré. Dès la première phrase : « Devant le lac, le ponton fait une ligne nette et lisse, une petite architecture impeccable », on sait qu’avec Sylvana Périgot on est en présence d’un auteur qui écrit à l’oreille, doué de cette capacité, rare chez trop d’écrivains contemporains, à mettre en musique des éléments visuels.
La suite ne dément pas, tant s’en faut, cette impression liminaire : Sylvana Périgot sait construire un monde où les sens – la vue, l’ouïe – les plus impliqués dans l’écriture et la lecture ne cessent d’être sollicités, pour notre plus grand plaisir : en témoigne, par exemple, ce passage, vers la fin (page 121) – mais tant d’autres pourraient faire l’objet d’une citation ! –, où s’exprime, au service de la description, une admirable science du rythme et des sonorités : « J’ai rouvert les yeux à travers un prisme qui divisait et multipliait chaque image de mon passé pour l’incorporer au tain miroitant du présent. Un silence absolu absorbe la forêt. La surface du lac est comme une vitre piquée de lumière devant la chair trouble du fond, plus sombre, presque sourde et marbrée de veines phosphorescentes. Chaque feuille de bouleau tremble dans le jour comme une goutte d’eau et chaque goutte d’eau contient dans un effet de loupe un événement microscopique. »
Un-œil-une-oreille : c’est, en substance, sous la forme de cette association qu’avec son habituelle acuité Rémy de Gourmont, dans son Problème du style (un livre essentiel [Mercure de France, 1902]), définissait le don d’écrire. Nul doute que ce don, Sylvana Périgot ne le possède, manifestant dans 3 balles perdues ce qu’elle est, foncièrement : une artiste. Je ne suis pas sûr que le roman soit la forme littéraire la plus propre à la mise en oeuvre de ses qualités stylistiques : peut-être le poème en prose y serait-il plus propice. Quoi qu’il en soit de cette réserve – à laquelle fait d’ailleurs pièce le concept de roman poétique illustré par les Gracq et autres Alain-Fournier : ce premier texte publié révèle un sacré coup de patte, et un auteur à suivre, indubitablement.
Une autre recension, sous la plume d’Angèle Paoli, à lire ici, sur Terres de femmes.
Une recension, 5 ans plus tard,
de L’Homme hermétique
(éditions Arléa, 2007).
C’est ici,
sous la plume d’Agnès Orosco,
Des extraits de Brueghel en mes domaines
(éditions du Vampire Actif, 2011)
sur Terres de femmes,
le blog d’Angèle Paoli.
Perse (34-62 ap. JC) : la lecture publique (Satires, I, 12-21)
Que faire ? J’ai la rate explosée de fous rires :
Prose ou vers, on se claquemure pour écrire
Ce toc où s’asphyxient les plus amples poumons.
Face au public, coiffé, portant nouveau veston
Et chevalière blanche ainsi qu’aux jours de fête,
On lit, juché bien haut, déliée la luette
D’un coup de gargarisme, et l’œil comme en orgasme.
Et là, sans retenue, la voix pleine de spasmes,
L’élite a le frisson si quelque vers s’arrime
À sa croupe fouillée du va-et-vient des rimes.
***
Cette traduction originale, due à Lionel-Édouard Martin, relève du droit de la propriété intellectuelle.
Il est permis de la diffuser, à la condition expresse que le nom du traducteur soit clairement indiqué.
***
Quid faciam? sed sum petulanti splene cachinno.
Scribimus inclusi, numeros ille, hic pede liber,
Grande aliquid, quod pulmo anime prælargus anhelet.
Scilicet hæc populo, pexusque, togaque recenti,
Et natalitia tandem cum sardonyche albus,
Sede leges celsa, liquido quum plasmate guttur
Mobile collueris, patranti fractus ocello.
Hic neque more probo videas, neque voce serena,
Ingentes trepidare Titos, quum carmina lumbum
Intrant, et tremulo scalpuntur ubi intima versu.
La Vieille au buisson de roses lue par Claire Laloyaux (sur Facebook)
 C’est encore avec un éblouissement renouvelé que j’ai lu cet autre roman de Lionel-Edouard Martin. Durant ma lecture, l’incompréhension s’est parfois mêlée à l’admiration car que je ne comprends toujours pas pourquoi cet auteur semble, au fond, encore si peu présent dans les mémoires des lecteurs, lui qui les creuse tant, les mémoires, pourtant, au travers d’une langue si pleine des sujets qui la parlent. A l’exemple de ce poète qui sert ses pairs en les traduisant avec rythme, et souvent avec humour s’agissant des poètes latins — ce qui me rappelle combien l’école avait pu leur façonner un masque austère —, il resterait encore à faire connaître ce rare styliste à tous ceux qui seraient encore sensibles à ce que la langue nous dit des solitudes humaines et des liens impromptus qui se tissent entre une vieille femme et un chien errant, puant, à la recherche d’un genou sur lequel poser son museau.
C’est encore avec un éblouissement renouvelé que j’ai lu cet autre roman de Lionel-Edouard Martin. Durant ma lecture, l’incompréhension s’est parfois mêlée à l’admiration car que je ne comprends toujours pas pourquoi cet auteur semble, au fond, encore si peu présent dans les mémoires des lecteurs, lui qui les creuse tant, les mémoires, pourtant, au travers d’une langue si pleine des sujets qui la parlent. A l’exemple de ce poète qui sert ses pairs en les traduisant avec rythme, et souvent avec humour s’agissant des poètes latins — ce qui me rappelle combien l’école avait pu leur façonner un masque austère —, il resterait encore à faire connaître ce rare styliste à tous ceux qui seraient encore sensibles à ce que la langue nous dit des solitudes humaines et des liens impromptus qui se tissent entre une vieille femme et un chien errant, puant, à la recherche d’un genou sur lequel poser son museau.
Car si le style de Lionel-Edouard Martin est flamboyant, presque étonnant en une époque qui a fait de l’écriture blanche une platitude, en cela bien éloignée des « ripés » sur lesquels s’époumonent les personnages et qui s’apparentent aux heurts de la syntaxe, le flamboiement du style et sa richesse lexicale, qui emporte plus qu’elle ne fait froncer les sourcils, évitent pour autant l’emphase et servent la pudeur de l’intrigue, ramassée en quelques mots ou presque car là n’est jamais l’essentiel. Il devient difficile, ensuite, d’écrire sur un tel texte sans céder à la tentation d’un mauvais lyrisme et d’échapper à un vague sentiment de honte, voire d’illégitimité, à prétendre en restituer une lecture.
Mais essayons quand même. Le roman suit alternativement trois personnages, une vieille, un peu bigote, un peu folle aux dires des rumeurs et des diagnostics psychiatriques ; un chien qu’elle appellera Diurc car la vieille a la passion des mouillures (tandis que je peine encore à les appliquer dans mon apprentissage solitaire du polonais, langue qui les affectionne tout particulièrement) ; enfin, un marquis, Olivier de Cruid, marquis de lui-même, comme l’écrit malicieusement LEM, facétieux quand il décrit la passion de l’érudition de son personnage, comme si, par là, il regardait avec une distance amusée sa propre passion de la linguistique comparée et des bouts de latin que l’on a gardé en mémoire quand la modernité a cherché à les oublier.
Des bouts de latin, bouts rimés, assonancés, hexamètres puis alexandrins français, l’auteur en parsème son texte, et alors que rien ne les annonçait, des étymologies surgissent au beau milieu d’un discours fleuri du marquis ou d’une prière fiévreuse de la vieille. Je n’ai pu m’empêcher de repenser à ces pages de vocabulaire latin que les khâgneux apprennent et surnomment, là encore malicieusement, pour amoindrir la douleur de la mémorisation, le « petit Martin », du nom de son auteur. Ce qui constitue pourtant le « petit Martin » de ce présent roman, ce ne sont pas des listes vite indigestes, faute d’être remises en contexte, mais bien plutôt un assemblage d’idiomes qui, à force d’être rythmés, prennent sens et contexte dans l’unité resserrée d’un petit village poitevin, M*, et d’un vague château moins décrit que le domaine alentour, plus touffu encore que le discours du marquis, et plus épineux que les roses du buisson de la vieille.
Ce n’est pas ici Horace, cher à l’auteur, qui hante ces pages : Virgile le dépasse et délivre peut-être une des clés du roman par son vers fameux pour son hypallage, « Ibant obscuri sola sub nocte per umbram ». Il n’est pas innocent qu’il soit tiré du livre VI de l’Enéide car ce chant est celui de la catabase, de la descente aux enfers d’Enée. Et de catabase il est peut-être aussi question dans La Vieille au buisson de roses. Ou, du moins, d’une traversée, d’une brutale révélation que connaîtront au moins deux des personnages, le marquis et la vieille.
Le premier la connaîtra lorsqu’il se décidera à enfin sortir de son domaine et affronter un vieux monde endormi duquel il s’était éloigné pour l’érudition. Après un trajet laborieux dans une voiture d’une autre époque, un passage au café du coin où il se pique peut-être de n’être pas suffisamment salué comme aristocrate par les habitués, le marquis arpente le village, gravit la pente puis tombe sur un arbre qui lui délivrera, croit-il, une vérité sur l’origine des langues. Moment d’épiphanie, comme se plaisent à les repérer les exégètes, la contemplation de l’arbre me rappelle ces brusques arrêts devant une nature qui échappe à jamais à l’homme dans certains films de Tarkovski, de Béla Tarr ou même dans les drames médiévaux de Bergman, films qui eux aussi se soustraient à toute mise en intrigue pour laisser parler un temps qui s’écoule inexorablement et une parlure que ne comprennent pas les profanes — je tisserais presque un parallèle entre la vieille qui se met à crier dans l’église à en faire rougir les autres paroissiennes et l’émouvant Valuska de La Mélancolie de la résistancequi reste incompris des autres habitués du bar lorsqu’il les oblige à former avec lui une étrange danse cosmique afin de restaurer, peut-être, une unité perdue.
Mais les parallèles pourraient encore se multiplier sans que rien soit vraiment dit de ce qui fait l’incroyable force du roman de Lionel-Edouard Martin. Reste de ce moment de brusque révélation pour le marquis qui, en même temps que de lui faire relire sa vie et sa recherche herdérienne, le fatigue tellement qu’il en meurt, l’impression d’avoir touché au cœur du secret des langues. Le magnolia contemplé par le marquis devient « l’arbre-cerveau », celui revêtu de la blanche tunique des anges, celui qui lui chuchote enfin tous les idiomes qu’il croyait perdus.
C’est toutefois la vieille qui les avait saisis avant lui, elle qui, pourtant, n’avait jamais approché les langues autrement que par le sensitif. Si la science réduira son don à des hallucinations auditives, le poète, lui, en tire une poésie et une cosmologie où hommes, bêtes et plantes communiquent, recomposent une origine des langues commune à tous les vivants. La crise de la vieille dans l’église à la Noël, précédée d’une montée difficile la nuit tombée, le ventre vide et gargouillant, pour rejoindre les croyants, était la première manifestation d’une prise de conscience, chez la vieille, en ses entrailles, de ce dont la langue est faite, de chair pétrie et mise en rythme. Et bien sûr la venue du chien, qu’elle recueillera, version burlesque et en même temps héroï-comique de la naissance du Christ, sans qu’il y tienne du plus bas blasphème, scelle cette traversée dans le langage.
Il n’est alors pas surprenant que ce qui s’apparente à un voyage mouvementé soit dit dans une langue qui elle-même cahote et confirme les intuitions de Meschonnic sur la poésie comme forme où « le discours tout entier est porté à l’état de subjectivité », comme « parabole du sujet ». D’un côté, le marquis dit mépriser les monosyllabes, trop vulgaires sans doute, tandis que de l’autre, chez la vieille, aidée par les aboiements de son Diurc, les monosyllabes sont préférés lorsqu’ils modulent un chant, dans un latin « qui pue », car il reste hermétique, ou dans des instants de glossolalie. C’est que le rythme se glisse dans des corps particuliers et redonne à la langue toute sa polysémie, à la fois langue apprise à l’école, transmise en héritage, soudure d’un peuple, voire d’un village seul, et langue-organe qui se gonfle de toutes les richesses des vocables au point de littéralement étouffer celui qui s’en enorgueillit. Bien terrifié est celui qui craint d’avoir la langue coupée, comme le petit Canetti au début de sa Langue sauvée (Die gerettete Zunge) car porteur d’un secret.
Alors il faut la sauver, cette langue, et la chanter, en restituer toute la tessiture, ce que fait la vieille sans même s’en rendre compte. Le sauvetage est tel que la vieille s’effondre dans sa cour, se vide, fait ses besoins, car ce qui lui est tombé dessus, non pas de simples pétales de rose, et qui attire inexplicablement le marquis, est d’un poids trop lourd pour cette fragile carcasse : la langue se déverse, se délie, fait dire par la bouche de cette sibylle — le début du chant VI n’est pas loin — une partie de sa force d’attraction. Transposée dans les terres de la Gartempe, la force prophétique devient quasi mystique et transforme les ombres que traverse cette trinité profane en anges à atteindre, à apercevoir à travers un quotidien qui ressemble fort à tels romans de Giono (il n’y a qu’à songer aux repas où l’on arrache voracement la viande, peut-être la saucisse, dans un intérieur sombre et pierreux).
La quête des personnages, qui commença par l’arrivée d’un chien, bâtard depuis des générations, s’achève brutalement par des corps qui tressautent, que l’on sent vivre en dehors d’eux-mêmes, puis qui s’arrêtent de bouger, exténués. Tout aussi brutalement, la révélation, le sursaut, la surrection, se dira en des expressions céliniennes, « Comment ça m’est venu. Comme ça. », ce « comme ça » est cette intuition éprouvée par la vieille et formulée avec des balbutiements par le marquis, « cette évidence que le langage c’est ça : cette matière angélique ». La matière angélique a relié les êtres et les choses, fait des pétales de rose des langues de feu, redonné au sensitif toute sa densité, même au fond du gosier brûlant et puant d’un chien. Quand l’unité perdue s’est reformée dans l’espace d’un texte composé en tableaux comme un retable, alors le mystère peut s’évanouir des êtres qui l’ont entrevu. Le marquis de Cruid, dans un éclair de lucidité, nous dit ainsi à l’issue de sa Passion, « Maintenant j’ai compris, maintenant je peux mourir ». Et nous, nous pouvons méditer sur ce Verbe entraperçu, cette origine des langues qui s’est ouverte timidement comme la dernière rose du buisson.
Malcolm Lowry (1909-1957) : Pas de route calme / No still path
Hélas, aucune route calme dans mon âme,
– Je suis mauvais –, aucune dans mes souvenirs ;
Aucune que ne tienne ou la goule ou le diable,
Où mes amours touchent des ailes et soupirent,
L’empruntant pour entrer en silence où le rêve
A sa place embrasée de fruits d’or, de clarté
Qui nimbe le visage irradié sans trêve
De l’amour – l’amour-même – et troue l’obscurité.
Il n’y a pas de route, aucune route, non
Sauf celle peut-être où va l’abstraction,
Où monte le précepte, où la métaphysique
S’écroule, où, délaissés, les principes claudiquent.
Aucune route, non, mais comme un fleuve en crue
Où se noyant, traînées, des formes gesticulent.
Alas, there is no still path in my soul,
I being evil, none of memory;
No path, untenanted by fiend or ghoul,
Where those I have loved best touch wings and sigh,
And passing enter silently the place
Of dream, illumined by bright fruit, and light,
That circles from the always brightest face
Of love itself, and dissipates the night.There is no path, there is no path at all,
Unless perhaps where abstract things have gone
And precepts rise and metaphysics fall,
And principles abandoned stumble on.
No path, but as it were a river in spate
Where drowning forms, downswept, gesticulate.
(in Selected Poems of Malcolm Lowry, City Lights Books, San Francisco, 1962)