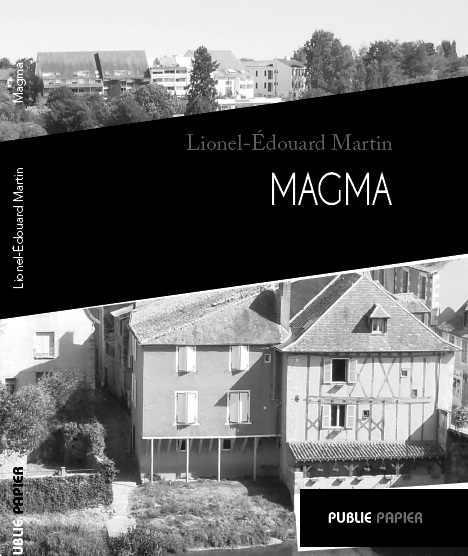Hasard de la vie lorsqu’elle rejoint le temps, toujours décalé, de la lecture, il se trouve que j’ai rencontré Lionel-Edouard Martin alors que j’étais encore plongée dans son Brueghel en mes domaines. S’il m’a pudiquement parlé de la genèse de ses textes, mon regard sur ce recueil de « petites proses sur fond de lieux » tâchera de rester nu, ouvert à la singularité de ces fragments qui résistent , à première vue, à toute unification.
Hasard de la vie lorsqu’elle rejoint le temps, toujours décalé, de la lecture, il se trouve que j’ai rencontré Lionel-Edouard Martin alors que j’étais encore plongée dans son Brueghel en mes domaines. S’il m’a pudiquement parlé de la genèse de ses textes, mon regard sur ce recueil de « petites proses sur fond de lieux » tâchera de rester nu, ouvert à la singularité de ces fragments qui résistent , à première vue, à toute unification.
Résistants à toute emprise, à toute réduction au seul thématique, tels sont bien, je crois, ces fragments, moins unis par la contrainte qui préside à leur écriture (le lieu) que par une même exigence poétique, tendue par l’image de la route serpentine, dessinant peu à peu un imaginaire personnel plus qu’un monde réel. Car ce recueil est tout entier inspiré par le mythe, qu’il soit mythe personnel (çà et là se ramassent des souvenirs du poète, nécessairement réinventés), mythe de l’origine de la langue, biblique donc charnelle — le verbe s’incarnant dans une bouche, d’abord d’ombre —, ou mythe de la création poétique, comme le suggère la toute dernière partie du recueil, « Incidences, hors tout », certes en marge des autres sections car plus critique, mais faisant retour sur les proses poétiques, morceaux épars conditionnés par un regard perçant sur la tessiture du réel.
La route n’est pas droite, en effet, ne s’achemine pas vers un but ; elle n’est pas rectiligne comme le serait un discours fermé sur la poésie. Celle-ci au contraire ne cesse, au fil des petites proses, de se densifier et de se resserrer autour de son secret. Perdue entre un réel magnifié par la langue et un imaginaire des poètes — plus que des langues, comme dans Avènement des ponts —, la poésie se niche dans ce qui paraît le plus insignifiant mais fondamentalement le plus beau car le plus fragile. Elle est d’abord ce qui s’impose à la vue du poète dans ses escales plus ou moins longues d’un continent à l’autre. Incarnée par une nature qui impose de savoir nommer les arbres, les fleurs ou les insectes peuplant le jardin, la poésie que chérit Lionel-Edouard Martin me semble moins être une poésie des choses, comme a pu la développer un Francis Ponge, au regard peut-être trop froid sur l’huître ou le cageot, qu’une poésie à la manière d’un Zbigniew Herbert. Certes moins marqué par la sensualité de la langue, le poète polonais me semble toutefois jeter un regard lui aussi sensible, quasi affectueux, sur ce que la « basse époque du facile et du tape-à-l’œil », aimant « le lisse, la glisse, la neige grasse », repousse dans l’anodin. Contre l’abandon de la nature à son seul dépérissement, Lionel-Edouard Martin cherche encore à dresser un pont entre les hommes du commun, les vrais humbles, et ces choses vivantes devenues, sous la langue de feu qui définit le langage, d’autres créatures, presque bibliques. Le regard du poète n’est plus seulement à hauteur d’homme : s’il scrute des cimes et un absolu, comme l’oblige la suprême poésie, l’écrivain redessine dans le même temps, me semble-t-il, une horizontalité qui ramène les hommes à leur petitesse et exhausse ces êtres de rien que sont la fourmi, l’iris, l’arum, le bourdon ou l’abeille.
D’abeilles il est fortement question dans ce recueil. Insecte butineur immortalisant les fragiles parfums des fleurs dans le miel, les frôlant sans les flétrir, l’abeille s’impose progressivement comme un symbole de la poésie — ce qu’elle est fondamentalement dans les toutes les cultures et religions. Tandis que Les Proverbes rappelle sa force besogneuse (« Va voir l’abeille et apprends comme est laborieuse »), certaine tradition musulmane hérésiarque en fait une version de l’ange — et une lecture attentive de l’œuvre de Lionel-Edouard Martin repérera la récurrence de la figure angélique, magnifiée quand elle n’est pas parodiée avec tendresse dans La Vieille au buisson de roses. Tour à tour symbole de la royauté, du principe vital (jusqu’à figurer sur les tombeaux comme appui de la survie post mortem), de la résurrection et du Christ, l’abeille est aussi, et c’est là qu’on en revient à la poésie, figuration du verbe. Un dictionnaire savant rappellerait que l’abeille en hébreu, « dbure », a pour racine « dbr », soit la parole. Car le poète aussi butine, dans le monde qui l’entoure, la substance qui nourrira, miellée, la parole pétrie par sa langue ventrue et sanguine. Le bourdonnement de l’abeille est comme l’envers d’un monde rendu obscur et grésillant puis tamisé et clarifié par l’ordonnancement des mots en une « syntaxe inouïe », d’abord oculaire — ce que rappelle, à l’entrée du recueil, l’épigraphe signée Claude Esteban, « Obscurs, nous sommes nés pour démêler l’obscur. Pour que vive, chaque matin, la route. ».
Ainsi, si je peinais à épouser le mouvement des premières petites proses, à en saisir la source et le sens (signification et direction), comme le fleuve-route qui matérialise l’écriture, celle-ci soudain révéla ses heurts et son « aller boiteux » dans l’alternance des lieux, des points de vue et des grossissements du réel. Si le poète engage son lecteur à se munir d’une pioche et d’une boussole, il lui faut aussi convertir son regard en une loupe correctrice, magnifiant les choses vues, absorbées et digérées par ses entrailles, comme le doit faire tout poète. L’aller boiteux affirme alors sa nécessité, les chemins de traverse, les raccourcis et impasses dévoilant une autre perception du réel. La simplicité de ce qui est décrit est en même temps étrange car rarement ennobli ainsi, ressaisi dans sa lenteur et sa fragilité. Loin d’être de simples clichés du réel, les petites proses disent quelque chose de détraqué, à l’image de l’horloge « devenue folle », d’un hiver pluvieux mais encore chaud, car « caraïbe », ou d’un automne aphasique, aux germes endormis dans une terre en jachère. C’est bien sûr la langue de Lionel-Edouard Martin qui singularise le réel dont il tire sa matière poétique : « Il n’est d’écriture que dans un ressenti particulier de l’univers, où les mots appellent, au-delà des êtres et des choses, un monde épuré de substance, où les corps sont de gloire et tiède la pierre — abolies frondes et catapultes. ».
Dans une langue ignée et remâchée, pétrie comme l’est le pain sec à l’aube, frottée, raclée et essorée comme dans un lavoir, l’écriture est expression d’un suc, tentation de l’épure : à mesure que le poète modèle son œuvre, son écriture « s’étrécit » en revenant à l’essentiel, en préférant « à l’opacité piquetée d’abeilles, la pure et simple transparence d’un jour d’été ». Non pas qu’il faille renoncer aux métaphores — que serait une écriture sans médiation ? —, mais plutôt creuser en soi et dans le vocable une parcelle de beauté restée terrée et tue, cette abeille que Virgile, dans les Géorgiques, fera naître, en dépit de toute logique — car la fable, comme la poésie, s’en moque — des entrailles des animaux sacrifiés par Aristée, rival malheureux d’Orphée. Fragile, comme le sont ces proses poétiques proches du verset — claudélien mais aussi biblique, tant l’ensemble du recueil est tenté par la Genèse, par le récit d’une autre création, poétique celle-là —, la beauté qui sourd de ces pages dit l’acharnement du poète à faire de la langue un espace à labourer, un sillon qui, contrairement au vers traditionnel, fait de moins fréquentes haltes et retours, libéré qu’il est dans la prose devenue nécessité par crainte de la folie.
La brèche s’ouvre par trouées, blancs sur la page, pulsations et ouverture d’une bouche gorgée de sang, ronde comme un nombril sans nœuds, dépendante de la digestion lente des mots-aliments. C’est par ce retour à la chair et au souffle que la poésie se gonfle et peut rendre la proie qu’elle a saisie pour la transformer (« Car tout poème, tout vrai poème des origines, tout vrai poème aboute — il aboute et métamorphose »).
Rebouchant l’espace laissé vide, favorisant le clinamen contre la solitude des atomes — les maisons aussi sont peuplées de fantômes, dit le poète —, le recueil tire paradoxalement sa dynamique de ses décentrements et de ses heurts. Après la floraison et le butinage vient une pluie lourde, désespérante, qui ponce toutes les aspérités : « Et s’il n’y avait, tout bonnement, purement, rien ? ». Minute de doute douloureuse et bouleversante, l’hypothèse du néant, d’un monde effeuillé et sans orbites, amène pourtant à creuser davantage le fond des lieux : « … Mais il y a quelque chose : on le sent par la peau. » Oui, on sent que les rigoles ne mènent pas à l’abîme, que l’accablement du poète, exilé sur les terres de Dalmatie — il me semble bien que l’Ovide des Tristes hante la cent-trentième page — n’éteint pas l’espoir, ne tarit pas l’inspiration. À mesure que le recueil fait grandir l’arbre-poésie, s’enroule autour de ses branches, augmente certes le poids des années sur les épaules de l’homme, mais augmente plus encore l’importance d’un retour à une source faite d’enfance et de poésie. Alors que les citations ne faisaient qu’ouvrir chaque section, elles s’invitent maintenant en fin de prose et la nourrissent, faisant du travail poétique un embranchement de réminiscences littéraires, de plus en plus chéries car de plus en plus resserrées autour de quelques rares figures, et de souvenirs d’enfance, comme l’amplifie l’émouvant poème en souvenir de la mère séparée du jeune enfant car fauchée par une ombre paternelle. Poésie comme enfance de la littérature et du monde, vieux mythe qui garde sa pertinence du fait même de ce qu’elle a engendré de figures monstrueuses, poètes talentueux et mères bercées par l’amour excessif et la haine. Poésie comme retour à l’originel, au ventre et à l’union première de l’enfant et de sa mère dans le sang et les fluides partagés dans la chaleur de quelques mois. Poésie qui se veut alors moins nostalgique d’une époque perdue que renaissance de ce qui la rendait si privilégiée et moite. Incapable de prétendre au récit linéaire et exhaustif, l’évocation d’un âge de bourdonnements, lorsque rien n’est compris mais seulement ressenti, se déploie en fragments, dans les vestiges d’une langue aussi charnue que les ventres flasques des accouchées. Accouchées bientôt grisonnantes puis spectrales, les mères ajoutent alors un autre temps à l’écriture : à celle, rétrospective, du bonheur puis de la trahison, s’ajoute une écriture de l’invocation des morts, inhumés, visités à la Toussaint, et des morts à venir, déjà salués dans une œuvre sinueuse, errante, comme le furent la descente et l’ascension d’un Dante, déjà projeté dans l’au-delà par ses chants.
Ami de cette traversée vers une lumière toujours inquiète, l’homme pourrait enfin s’unir, à défaut de la comprendre, à l’abeille qui, confie la tradition, deviendrait mère par le simple travail de ses « lèvres ». Brueghel, s’il s’agit bien de l’Ancien, l’avait peut-être suggéré dans un dessin à la fin de sa vie…
Si vous souhaitez partager