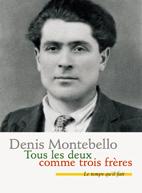Lire un nouveau roman de Romain Verger, c’est comme assister à l’expansion d’un univers qui, depuis le point d’origine du big bang (Zones sensibles), ne cesse de déployer une matière entre toutes identifiable : des mondes pour constituer un monde, unique dans tous les sens du terme, et qui vous accrochent au passage, quoi que vous en vouliez, fussiez-vous à des années-lumière, du fait de vos goûts personnels, de ces étrangetés sauvages, pour vous happer et vous inclure, presque à votre corps défendant, dans leur mouvement gravitationnel.
Lire un nouveau roman de Romain Verger, c’est comme assister à l’expansion d’un univers qui, depuis le point d’origine du big bang (Zones sensibles), ne cesse de déployer une matière entre toutes identifiable : des mondes pour constituer un monde, unique dans tous les sens du terme, et qui vous accrochent au passage, quoi que vous en vouliez, fussiez-vous à des années-lumière, du fait de vos goûts personnels, de ces étrangetés sauvages, pour vous happer et vous inclure, presque à votre corps défendant, dans leur mouvement gravitationnel.
À franchement parler, je ne me sens d’ordinaire guère d’accointances avec le genre de littérature dans laquelle excelle Verger ; je l’évite même comme la peste, n’y trouvant pas mes marques : c’est juste affaire de sensibilité, de prédilection. Seulement voilà : vous parcourez un jour Forêts noires, un peu rétif à vous y plonger, et vous vous laissez prendre au piège, comme un bleu, de ce texte (sans doute curieusement mal fichu, mal fagoté dans sa composition, mais qu’importe), et désormais c’en est fini de vous, de vos convictions pourtant bien ancrées : Abandonne tout espoir, toi qui entres ici, vous n’aurez plus de cesse que de tout lire de cet animal de Verger, pour constater que de livre en livre, c’est ce même entrecroisement des mêmes thèmes obsessionnels, ce tissu qu’on reconnaît immédiatement de l’œil, et dont les motifs – exaspération des corps à la torture, maladie, folie, mort, liquides de toutes sortes, etc. –, constamment prégnants, semblent s’opposer au tissage d’une langue impeccablement classique, remise cent fois sur le métier, et puissamment empreinte de poésie (Verger est aussi poète, à moins que foncièrement poète).
Lisant Fissions, vous ne coupez pas à pareille impression d’une écriture en décalage avec ce qu’elle exprime de sens – et elle exprime quoi donc, dans ce roman ? – je doute qu’on puisse résumer ce texte pour le ramener à sa seule substance narrative, à moins que cette condensation n’y suffise : jour de mariage raté dans une famille de cinglés dont la folie emporte le narrateur dans son sillage et sa dérive, onirique ou pas – allez donc savoir ! – jusqu’à l’automutilation et à la réclusion dans un asile (ce qui n’est pas sans rappeler, dans une certaine mesure, l’histoire de Zones sensibles). Ô dingos, ô châteaux : c’est, si j’ai bonne mémoire, le titre d’un roman de Manchette : il aurait pu s’appliquer aussi bien à Fissions. J’ai du reste bien tort de m’escrimer à vouloir résumer, quand tout est dit, ou presque, page 60 par le narrateur de cette bien glauque et funeste histoire :
En voulant m’épouser tout là-haut, sous ces rayons ultimes, tu croyais que notre rencontre inonderait de lumière cette maison où tu es née et a incubé la folie des tiens, où le mal a poussé et disséminé, frayant ses racines dans les sagnes (sic) turpides où ces montagnes trempent leurs pieds flétris.
Sur cette base, il n’est guère difficile – même si ça l’est – d’imaginer ce que ça peut donner en matière narrative et descriptive – âmes sensibles s’abstenir. Mais, pour y insister : de nouveau ce paradoxe, pour exprimer cette matière, d’une langue fort soignée, d’un style de très haute tenue, dont la maîtrise, le côté pourléché, me semble à l’opposé de l’idée qu’une écriture devrait mimer ce qu’elle raconte, lui emboîter le pas, se faire mimésis d’un narré dont elle serait vassale (cf. le tout récent, tout beau roman, Coup de tête, de Guillaume Vissac).
Rien de cela, chez Verger. Tout le contraire, même. À folie – même pas douce : abrupte, rugueuse, sanguine, absolu dérèglement de tous les sens –, style parfaitement classique. Qu’on en juge par l’incipit :
Qu’ont-ils faits de nous, Noëline, qu’ont-ils fait de toi ? Peut-on mieux dévoiler l’amour à ceux qui s’y destinent qu’en les séparant comme on tranche les siamois, en taillant dans la chair et brisant l’os iliaque, dans le vif des deux, en dédoublant le mal, en répliquant la nuit ? Pour te retrouver, te voir, je suis du bout des doigts les nouveaux traits de mon visage, cette page de braille qu’est devenue ma face : arêtes, séracs, fissures, escarpes, l’exact calque en trois dimensions de ce pays montagneux dans les plis contractés duquel a couvé notre union. (p. 11)
Indépendamment du sens qui fait de ce paragraphe une admirable introduction thématique à Fissions, même l’oreille la moins exercée reconnaîtra, çà, là, une savante orchestration de rythmes pairs et impairs, où l’alexandrin vient vous titiller le tympan, où les sonorités y vont de leur musique, tantôt délicate (flûte), tantôt plus âpre (cuivres), sur fond de timbales bien tempérées. Hiatus que dalle : de la musique avant toute chose, vous dis-je, un côté moderne Racine (tragédie : le terme est d’ailleurs employé p. 54) : en dédoublant le mal, en répliquant la nuit. Ce ne sont pas là des exceptions, tant s’en faut : le texte est truffé de ces effets de rythme, qu’ils ponctuent comme d’une mélodie obsessionnelle, comme d’un leitmotiv fondé sur la cadence. À croire que cela dissimule quelque chose, que quelque chose y réside qu’il conviendrait sans doute d’analyser pour tâcher d’en percer le mystère.
Tragédie ? On se souvient que le terme est en rapport étymologique avec le bouc, offert chez les anciens Grecs en sacrifice (p. 51) aux dieux lors de leurs représentations théâtrales rituelles. Ici, tout part d’un singulier méchoui, dans lequel l’agneau traditionnel se voit curieusement remplacé par un malheureux bouc. Un bouc bien vivant, une superbe bête à robe blanche, le poil long, ondulant et soyeux, dont les cornes puissantes s’incurvaient et pointaient vers le ciel en esquissant les hanches d’un lyre parfaite (p. 49), qu’il va s’agir d’égorger de main de marié. De marié ? – non, c’est la mariée qui finalement s’y colle – n’a-t-elle pas, en tant qu’actrice, interprété le rôle de Polyxène dans l’Hécube d’Euripide – une immolation pour une autre – ? Après sanguinolent massacre, la bête emblématique, embrochée, tournera longuement au-dessus des braises avant que la chair coriace n’en soit mastiquée en communion par les commensaux – « prenez, mangez-en tous : ceci est notre corps tragique ».
Rien de tout cela ne saurait être insensé dans un roman si court (138 pages), dont la brièveté même ne supporterait pas l’insignifiance ou l’écart anecdotique. Qu’est-ce que cela signifie donc, s’il faut y percevoir du sens ? J’y vois un maître verbe : pervertir. Pervertir l’attendu (non pas l’agneau, le bouc), et plus généralement, si je tente de calquer le passage pour la reporter à l’ensemble du texte, pervertir le respect dû à cette espèce de mimésis dont j’ai parlé plus haut. Question de style : discordance. Écrire l’atroce dans l’alignement parfaitement classique de la langue. À cet égard, une autre scène me paraît exemplaire :
Combien de nuits avions-nous passées dans le parc du Château de Versailles, déambulant en Rois soleil entre Hercules et Apollons. Nous nous faisions la courte échelle et franchissions son mur d’enceinte. Nous jouions à cache-cache dans les allées labyrinthiques du Bosquet de la Reine, nous buvions au pied marbré des éphèbes, nous nous déculottions devant Vénus et nous laissions branler par la main géante d’Encelade. Nous saluions de quelques pets, le corps lapidé par Zeus. (p. 37)
Irrévérence de quelque folle jeunesse ? Sans doute. Mais qu’est-ce au fond que l’irrévérence qu’un désaccord avec les faits et l’attendu ? On trouve quelques pages auparavant (p. 29) ce qui me semble être la clé de ce décalage, son explication. Le narrateur, engagé dans une déchèterie aux apparences de station d’épuration, y a pour fonction de retirer de la fosse à merde (p. 28) tout ce qui n’est pas liquide :
Quand je fouillais là-dedans, c’était en moi-même que je remuais, j’accomplissais mon destin d’homme en travaillant ma matière et en perfectionnais la vanité […] Le soir, je sentais remuer et brasser dans mon ventre la chierie dont je m’étais repu depuis le matin. (p. 29)
Travaill[er] [s]a matière, perfectionner : c’est moi qui souligne. Tout est dit dans ces termes : comme si la purge des passions (ici la chierie) – la catharsis aristotélicienne – s’opérait par le style sur ce que l’être humain peut receler de moins noble et de plus impur. Comme chez les tragiques grecs : une esthétique pour contrer les ravages de l’inconscient dans ses manifestations les plus cruelles : on cisèle le brut et la brute, pour, leur donnant belle forme, les exorciser : le marbre œuvré contre l’atrocité, Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Une esthétique (celle de la tragédie grecque) à vous crever les yeux, lecteurs, pour vous montrer sans que vous puissiez voir, ou envisager de – mais je n’en dirai pas plus sur le thème d’Œdipe, bien présent dans le texte, n’en voulant pas dévoiler plus avant la substance, et lever tout suspens.
Car il faut lire, urgemment, Fissions – peut-être est-ce le roman le plus achevé de Romain Verger – et entrer dans cet univers singulier où l’on est comme aspiré. Et dans la foulée, si ce n’est déjà fait, se plonger dans Zones sensibles, Grande Ourse, Forêts noires. Pour faire une rare expérience de lecture et de littérature contemporaine. Pour en sortir changé : parce que tout grand livre, s’il vous transporte, vous transforme, et donne à votre regard une nouvelle acuité.